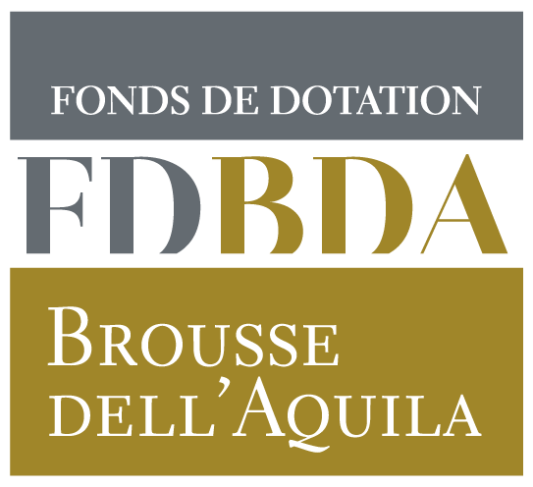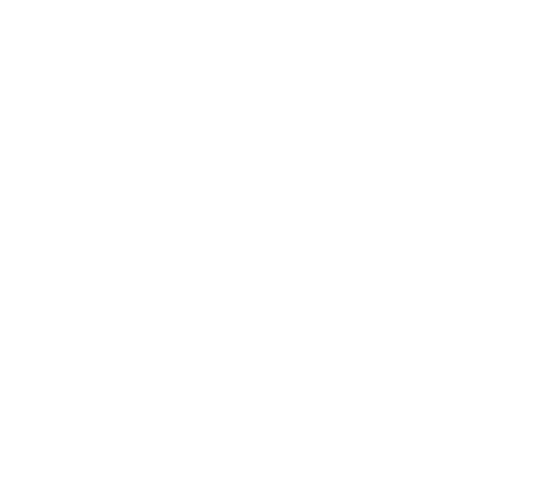Xi Jinping et Recep Tayyip Erdogan à Pékin le 2 juillet 2019. Wang Zhao/AFP.
Emmanuel Véron, Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) et Emmanuel Lincot, Institut catholique de Paris
La République populaire de Chine et la Turquie comptent parmi les puissances non occidentales les plus actives sur la scène internationale. Leur relation, qui s’inscrit dans une histoire longue de plusieurs siècles, gagne dernièrement en intensité, aussi bien sur le plan politique et diplomatique qu’au niveau économique.
D’un côté, la Turquie constitue pour Pékin un partenaire de premier plan au Moyen-Orient. De l’autre, la Chine représente aux yeux d’Ankara un acteur économique et politique alternatif à l’Occident – un Occcident avec lequel la Turquie, bien que membre de l’OTAN, entretient des rapports pour le moins tendus.
Comme dans ses relations avec les autres États du Moyen-Orient, Pékin a diversifié le spectre de ses domaines de coopération avec le pays présidé par Recep Tayyip Erdogan : leurs échanges concernent, outre les questions diplomatiques, des domaines aussi variés que la défense, les technologies, l’énergie ou les infrastructures. Ainsi, en bonne partie du fait de la participation d’Ankara aux Nouvelles routes de la soie, la Chine est devenue, ces dix dernières années, l’un des principaux partenaires commerciaux de la Turquie.
Pour autant, cette relation demeure sujette à des discordes liées notamment à la question ouïgoure, qui provoque des controverses au sein même du gouvernement turc.
Une relation pluriséculaire
Aux deux extrêmes de l’Eurasie, les civilisations turque et chinoise ont appris à se connaître au fil des siècles. Il suffit de visiter les salles du Palais de Topkapu Sarayi d’Istanbul et leurs collections de porcelaine chinoise pour s’en rendre compte. Elles témoignent d’un transfert de savoir-faire : celui permettant la conception d’une porcelaine peinte en bleu sous une couverte incolore. Sa conjugaison avec le kaolin, une argile blanche, naît à Jingdezhen (province méridionale chinoise du Jiangxi), vers 1320-1330, à la faveur de l’apport d’un minerai de cobalt provenant des confins du monde turc et de la Perse.
Deux mondes sont alors connectés, sous l’égide des dynasties gengiskhanides de Chine – les Yuan (1279-1368) – et de la Perse – les Ilkhanides (1256-1335) : ces deux empires sont à l’origine d’une commercialisation du « bleu blanc » et ce, à une échelle sans précédent.
C’est à cette époque que le Jame al-Tawarikh (que l’on pourrait traduire par Histoire universelle) de Rashid al-Din (1247–1318) est composé. C’est le premier récit en langue persane abordant des faits historiques de la Chine. En 1516, Sayyed Ali Akbar Khitai, s’en inspirant sans doute, écrira à son tour une somme, le Khitai-nameh. Des siècles durant, ce texte fera autorité sur ce pays et sera d’ailleurs davantage lu dans sa version turque.
Avec la révolution industrielle et l’essor des puissances européennes au tournant des XIX° et XXe siècles, les élites turques et chinoises se forgent soit dans des idéologies clairement anti-européennes soit, au contraire, dans la fascination que les cultures occidentales leur inspirent. Quand les empires chinois et ottoman s’effondrent, émerge l’idée de confraternité eurasienne à laquelle les peuples turcophones et musulmans de l’Asie centrale resteront particulièrement sensibles. Surtout lorsqu’il s’agit pour les dirigeants actuels de la Turquie et de la Chine de flatter l’orgueil de leurs peuples respectifs en cultivant une certaine nostalgie de leur histoire impériale.
La fin de la guerre froide accélère le rapprochement entre Ankara et Pékin. Ce phénomène est d’ailleurs propre à l’ensemble de la région) : que ce soit les monarchies du Golfe, la Syrie ou l’Irak, tous les pays du Proche et du Moyen-Orient accueillent progressivement des installations chinoises soutenues par les géants étatiques (Sinopec, Merchant Bank, ICBC, Agricultural Bank of China, etc.) dans les domaines les plus divers : gestion et participations dans des ports, industrie automobile, textile, transports…
Développement des relations économiques…
Les années 1990 et 2000 sont marquées par la progression des relations commerciales, toujours déséquilibrées au profit de Pékin. La Turquie importe une large gamme de produits chinois, sans pouvoir en retour exporter à la hauteur des capacités chinoises – aussi parce que le marché chinois lui reste en partie fermé.
Plusieurs années de négociations seront nécessaires à une véritable diversification des échanges qui intervient au cours de la dernière décennie, particulièrement pour des produits alimentaires (notamment laitiers) turcs sur le marché chinois.
Pékin effectue, à travers différents opérateurs privés et publics, divers investissements et prêts dans les infrastructures en Turquie (ports, routes, ferroviaires ou infrastructures urbaines et aéroports). L’un des cas les plus éloquents est probablement celui réalisé par l’opérateur COSCO, qui a acheté les deux tiers des actions du port de Kumport, à proximité d’Istanbul, pour une valeur de près de 1 000 millions de dollars.
Pékin déploie également un activisme notable dans le paysage bancaire turc. L’Eximbank, l’ICBC et la China Development Bank investissent dans de nombreux projets (infrastructures, énergie, immobilier etc.). La dynamique des relations est favorable au déploiement des géants du numérique chinois, notamment Huawei, Alibaba et ZTE, qui ont accru leurs parts de marché en Turquie au cours de la décennie écoulée, effectuant notamment plusieurs acquisitions (48 % du leader turc des équipements de télécommunication Netas, et 75 % du site de commerce en ligne Trendyol).
En outre, dès le début de la pandémie de Covid-19, Pékin a envoyé puis vendu du matériel médical à la Turquie, des masques aux vaccins. Si la livraison de ces derniers se révèle d’ailleurs plus problématique que prétendu par la RPC, il n’en reste pas moins que cette dimension sanitaire de la coopération témoigne de la capacité de la Chine à s’imposer dans cette partie du monde.
… malgré le point de discorde ouïgour
Recep Tayyip Erdogan a, dans un passé récent, fait grand cas de la continuité ethno-linguistique ouïgoure, d’Istanbul à Urumqi. Dès lors, la question du Xinjiang et des répressions des Ouïgours par le régime communiste chinois a suscité, ces dernières années, plusieurs dégradations (ponctuelles mais redondantes) des relations entre Pékin et Ankara. Rappelons que la Chine et la Turquie ont signé un traité d’extradition et que de nombreux Ouïgours installés en Turquie craignent d’être envoyés en Chine.
La Turquie a apporté un soutien pour l’essentiel déclaratif aux Ouïgours de Chine et accueilli sur son territoire un certain nombre de ressortissants de cette minorité nationale turcophone. Toutefois, la « question ouïgoure » constitue une variable d’ajustement de la politique d’Erdogan.
Ainsi, suite aux émeutes et répressions au Xinjiang en 2009, Recep Tayyip Erdogan dénoncera une « sorte de génocide » perpétré par Pékin ; mais en 2013, lors d’une visite d’État en Chine, il a souligné la menace constituée par les mouvances djihadistes pour la Chine et s’est opposé à toute remise en cause de l’intégrité du territoire chinois, effectuant d’ailleurs une escale au Xinjiang avant son retour en Turquie.
La dernière visite du président turc, en 2019, apportera la confirmation d’une volonté affirmée du développement des liens commerciaux et technologiques, sur fond de convergence politique entre Ankara et Pékin au Moyen-Orient et en Asie centrale, les deux puissances souhaitant intensifier les relations avec les pays non occidentaux et peser dans cette immense zone.
Et maintenant, des relations tous azimuts ?
Depuis 2013, la Turquie a souligné à maintes reprises le rôle qu’elle souhaiterait jouer pour renforcer la connectivité entre la Chine et l’Europe. Signe qui ne trompe pas : quelques mois seulement après l’échec du coup d’État de 2016, alors fermement condamné par les autorités chinoises, Erdogan a nommé ambassadeur à Pékin Abdülkadir Emin Onen, un homme d’affaires – et non un diplomate de carrière –, afin de densifier cette coopération économique.
Le CCWAEC (China-Central West Asia Economic Corridor), qui passe par l’Asie centrale, l’Iran et la Turquie, est une ramification des Nouvelles routes de la soie qui conforte Ankara dans son ambition de se désenclaver, y compris par la promotion de ses propres projets comme le corridor de transport Lapis Lazuli, qui vise à développer route et voie ferrée pour relier l’Afghanistan à la Turquie en passant par le Turkménistan, l’Azerbaïdjan et la Géorgie.
La politique de Pékin vis-à-vis d’Ankara est également corrélée à plusieurs projets de ventes d’armes. La Chine souhaitait notamment, en 2015, vendre à la Turquie un système modernisé de dispositifs antiaériens (12 batteries de missiles HQ-9 (DF 2000), dérivés du S 300 russe) – un projet qui, pour l’instant, ne s’est pas concrétisé (en partie du fait de la pression américaine). Plus tard, Ankara a privilégié l’achat de S-400 russes. Mais l’achat d’armes à la Chine dans l’avenir demeure tout à fait possible.
La dégradation des relations avec l’Occident (Europe, États-Unis et cadre otanien), les réflexes post-impériaux d’Ankara, qu’on constate notamment dans sa politique agressive en Méditerranée, et la faiblesse de ses infrastructures et de son économie convergent pour pousser Erdogan vers un choix stratégique plus tourné vers l’Est. La Turquie n’est pas membre de l’Organisation de coopération de Shanghai, mais partenaire de discussion. À ce titre, elle participe à diverses réunions et aux sommets annuels, mais elle souhaiterait aller plus loin et intégrer pleinement cette structure non occidentale, comme l’a fait l’Iran en 2021.
Si le rapprochement se poursuit entre Ankara et Pékin, malgré les tensions récurrentes autour de la question ouïgoure, ce sera avant tout un succès chinois qui confirmera, aux yeux de Pékin, que l’Occident se désengage toujours plus du Moyen-Orient et que la Chine y (re)trouve progressivement une place interprétée comme lui revenant de droit.
Emmanuel Véron, Enseignant-chercheur – Ecole navale, Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) et Emmanuel Lincot, Spécialiste de l’histoire politique et culturelle de la Chine contemporaine, Institut catholique de Paris
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.