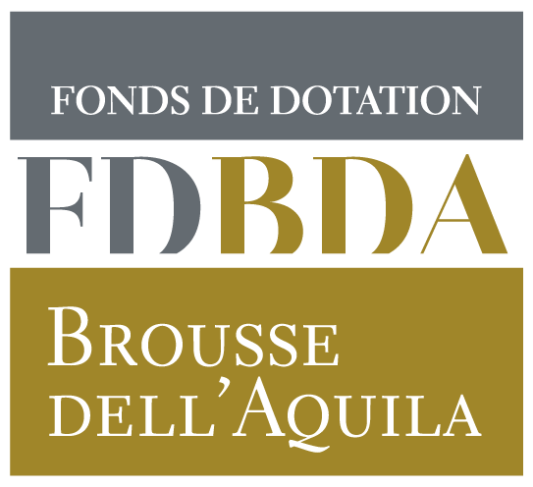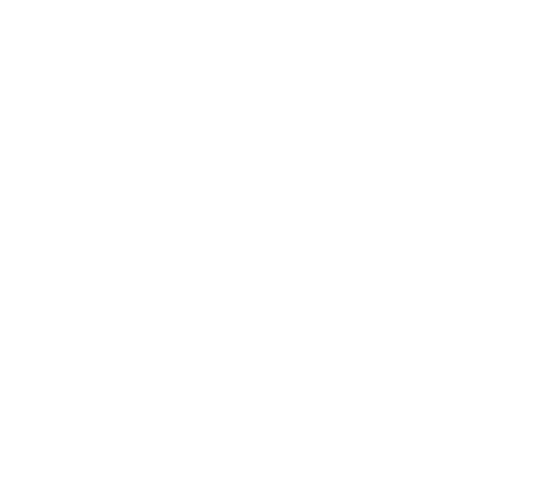Emmanuel Véron, Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) et Emmanuel Lincot, Institut Catholique de Paris
Au cours de ces dernières années, la Chine a interné plus d’un million de musulmans du Xinjiang dans des camps dits de « rééducation » (ou « centres de transformation par l’éducation »).
On aurait pu s’attendre à ce que les États musulmans du monde entier, prompts à se présenter comme les protecteurs sourcilleux de leurs coreligionnaires installés en Occident, condamnent unanimement, avec la plus grande force, le sort réservé aux Ouïghours et aux autres musulmans du Xinjiang (Tadjiks, Kirghizes, Kazakhs, etc.).
Mais à l’ONU, ce sont essentiellement les démocraties occidentales qui se sont émues de ce véritable scandale humanitaire ; en revanche, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (ou encore la Palestine) ont rallié le bloc des pays qui soutiennent Pékin. Même la Turquie, un moment active sur la question ouïgoure, accorde désormais la priorité à sa coopération avec Pékin. Du reste, c’est aussi pour ménager la Chine, soutien privilégié du régime birman, que les États musulmans ont adopté depuis des années un profil très bas sur les persécutions infligées aux Rohingyas.
Ces simples rappels suffisent à déconstruire le mythe d’une « solidarité islamique » qui serait automatique et universelle. En attendant, l’étau se resserre sur les musulmans du Xinjiang qui ont longtemps oscillé entre espoir de réforme, panturquisme (pour les Ouïgours), attentisme – pour le plus grand nombre – et radicalisation : certains ont rallié Daech ou Al-Qaïda, notamment en Afghanistan, où le retrait programmé des Américains, conjugué au retour des maquisards ouïgours anciennement actifs sur les terrains syrien et irakien, pourraient à terme affaiblir un peu plus le Xinjiang voisin et les intérêts chinois.
L’intérêt de longue date de Pékin pour Kaboul
La frontière séparant l’Afghanistan de la Chine, d’une longueur de seulement 80 kilomètres, se trouve dans le prolongement du corridor de Wakhan (qui se trouve sur le territoire afghan).
Les relations entre les deux États ont été établies dès 1955. Zhou Enlai, alors ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, se rendit en Afghanistan moins de deux ans plus tard. Pékin a su maintenir des contacts avec les différentes factions tandis que le pays était déchiré par la guerre civile puis envahi par l’URSS à partir de 1979. Discrète mais efficace, la Chine de Deng Xiaoping, dans le cadre de sa concurrence avec Moscou, offrit une assistance logistique aux moudjahidines, alors également épaulés par la CIA et les services secrets pakistanais (ISI) dans leur lutte contre les Soviétiques.
Plus tard, Pékin n’hésitera pas à reconnaître le régime des talibans jusqu’à son effondrement, en 2001 (les autorités chinoises entretenaient un lien discret avec le mollah Omar). Par la suite, à la différence des Occidentaux, la RPC n’a jamais écarté les talibans des négociations, cherchant au contraire à les associer aux discussions organisées à Pékin : aux yeux des Chinois, cette approche pouvait leur permettre d’accroître leur influence sur le territoire afghan, dont les potentialités et les ressources sont considérables.
L’Afghanistan, eldorado minier et enjeu sécuritaire
Pékin a ainsi massivement investi dans la prospection pétrolière du bassin de l’Amou Darya, où la China National Petroleum Corporation (CNPC) est très présente. La Chine se consacre aussi à l’exploitation des mines de cuivre d’Aynak dans le sud-est du pays, par le biais de deux de ses sociétés : la China Metallurgical Group Corporation (MCC) et la Jiangxi Copper Company Limited. Ce projet s’est pour la première fois concrétisé à l’issue de la visite du président Hamid Karzai (proche des États-Unis et du Royaume-Uni) à Pékin en janvier 2002. À cette occasion, le gouvernement chinois s’était engagé à fournir 150 millions de dollars à Kaboul (un montant comparable à celui accordé par les Occidentaux et le Japon réunis).
Cette aide, déjà substantielle pour l’époque, s’inscrivait dans la volonté de Pékin de contribuer au développement de son voisin pour y éradiquer les maquis islamistes d’Al-Qaïda, qu’avaient alors rejoint un certain nombre de terroristes ouïgours, autour d’un groupuscule appelé l’ETIM (Mouvement islamique du Turkestan oriental). Ce dernier a proclamé à partir de 2016 la « guerre sainte » contre Pékin afin de « libérer le Xinjiang des envahisseurs communistes ». À noter que, en un geste destiné à réduire dans la mesure du possible les répressions chinoises contre les Ouïgours, répressions largement justifiées par le danger djihadiste que ceux-ci représenteraient, Washington vient de retirer l’ETIM de sa liste des organisations terroristes.
Le retrait de la liste des organisations terroristes d'un groupe ouïgour affilié à Al-Qaïda fait débat. Hypocrisie américaine ou impératif humanitaire ? https://t.co/TG3yRK1lLq @Tantalite
— Le Point (@LePoint) November 23, 2020
Le but est donc, pour Pékin, de prévenir le maintien d’un foyer d’instabilité, de couper les terroristes de leurs bases arrière et d’éviter tout phénomène de contagion susceptible, à terme, de provoquer des troubles dans sa province occidentale du Xinjiang. Enfin, le retour à la stabilité en Afghanistan permettra d’éviter une pérennisation de la présence et de l’influence américaines dans ce pays que convoite également l’Inde, autre grand rival de la Chine, ce que symbolise le financement et la construction par New Dehli du grand barrage de Salma. Sans oublier que Pékin cherche à lutter contre le trafic de drogue en provenance d’Afghanistan et qui transite via le Tadjikistan jusqu’en Chine ouïgoure.
Pour sanctuariser ses intérêts, Pékin a ouvert au Tadjikistan voisin une base militaire (la deuxième après celle de Djibouti, et à l’extérieur de ses frontières, d’une configuration plus réduite et discrète). Des patrouilles chinoises (parfois conjointes avec les forces afghanes) se rendent régulièrement sur le territoire afghan et l’aide apportée par Pékin au développement des capacités de l’Armée nationale afghane (ANA) et du reste des forces de sécurité du pays s’est élevée à plus de 70 millions de dollars entre 2015 et 2018.
Fondamentalement, cette stratégie chinoise s’inscrit dans la continuité du « développement du grand Ouest » (Xibu da kaifa), initiée il y a plus de 20 ans par le premier ministre Zhu Rongji, pour étendre une « politique du pourtour » (zhoubian zhengce) et s’assurer ainsi un environnement régional stable pour garantir la sinisation et le développement du Xinjiang et celle des pays limitrophes.
L’OCS au cœur du dispositif chinois
En cela, la politique intérieure de la RPC est étroitement liée à sa politique centre-asiatique. Dès le sommet de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) tenu à Tachkent en 2004, la Chine a associé les autorités afghanes aux discussions, comme membre observateur. Cette ouverture est essentielle, et les grandes capitales centrasiatiques l’ont bien compris. Ainsi, à l’issue de la conférence de Doha de septembre 2020 qui réunissait les représentants des talibans et le gouvernement afghan, le chef de l’État ouzbek Shavkat Mirziyoyev propose l’établissement d’un comité permanent des Nations unies sur l’Afghanistan. L’Ouzbékistan s’est vu confier par l’OCS l’ouverture d’un Bureau général de renseignement destiné à rendre plus efficace la lutte entreprise par chacun de ses membres contre le terrorisme islamiste.
Tout pays membre de ladite Organisation, au nom de sa coopération sécuritaire, se doit de remettre à Pékin des personnes considérées comme suspectes par les autorités chinoises. Ainsi, la nasse se referme sur les activistes ouïgours. Même la Turquie avec laquelle l’intelligentsia ouïgoure a noué, par affinités de langue et de culture, des relations étroites, a fini par lui tourner le dos et par se rapprocher de Pékin.
La #Turquie envoie des réfugiés #ouïgours en #Chine, où ils risquent d'être sévèrement emprisonnés et persécutés, selon un rapport publié dans le Telegraph https://t.co/XEM3O7voUu
— Globalnews (@pascalpernai) July 27, 2020
Toutefois, la diplomatie turque essaie en Asie centrale et vis-à-vis de l’Afghanistan d’être également une force de proposition. Voyant sa candidature à l’Union européenne rejetée, sa diplomatie, chaque année davantage, reconsidère ses objectifs plus à l’est.
Très significatif est le lancement depuis 2011, par Ankara, du « Processus d’Istanbul – Cœur de l’Asie », une émanation de l’Organisation de coopération islamique (créée en 1969 par l’Arabie saoudite). Cet organisme se donne pour objectif « la stabilité et la prospérité au cœur de l’Asie par des mesures de confiance et des intérêts régionaux partagés ». Quinze pays d’Asie et du Moyen-Orient (dont la Chine et la Russie) en sont membres.
Le processus avait été accueilli à Pékin, en octobre 2014, pour aborder les problèmes sécuritaires posés notamment par le retrait programmé des troupes de l’OTAN d’Afghanistan. En décembre 2015, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, assistait à la 5e conférence ministérielle du Processus d’Istanbul – Cœur de l’Asie sur l’Afghanistan, se déroulant cette fois à Islamabad, au Pakistan. Si les initiatives des pays membres de ce Processus n’ont pas été abandonnées, comme le rappelle le sommet organisé par Recep Tayyip Erdogan à Istanbul en décembre 2019, elles ont laissé place à un projet plus global et qui reste une priorité pour Xi Jinping. Il s’agit de la Belt and Road Initiative (BRI).
En 2019, suite à la rupture des négociations entre Washington et les talibans, la Chine réactive une médiation entre les parties afghanes rivales afin d’aboutir à une « paix durable et globale ». C’est à la suite de cette initiative que les autorités chinoises obtiennent de leur allié pakistanais l’ouverture de cinq postes de douane pour désengorger le trafic de ses échanges commerciaux entre l’Afghanistan et sa périphérie pakistanaise qui transitaient jusqu’alors pour l’essentiel par l’une des rares routes assurant l’approvisionnement de l’Afghanistan depuis le port de Chabahar, en Iran, pays avec lequel la Chine a par ailleurs signé, en juin 2020, un accord de coopération économique et militaire de 400 milliards de dollars, pour les prochaines 25 années.
Si cet accord est entouré d’un halo d’opacité (ne serait-ce que pour ce qui concerne son montant), l’objectif est clair : créer un vaste réseau de communication pour pacifier ces régions et éradiquer systématiquement toute forme de dissidence pour y faciliter le développement des intérêts chinois.
La répression des Ouïgours : dossier international autant qu’intérieur pour Pékin
Si la répression des populations musulmanes sur le territoire chinois s’est considérablement intensifiée depuis 2015, suite à de multiples attaques terroristes commises en divers points du territoire de la RPC (Yunnan, Xinjiang, Guangdong, Pékin, etc.), l’accélération des politiques dites « anti-terroristes » et « anti-extrémistes » a une dimension internationale. La guerre en Syrie et l’affirmation à partir de 2013-2014 de Daech (qui, on l’a dit, comptait dans ses rangs un nombre incertain mais considérable de Ouïgours) a contribué au renforcement de dispositifs sécuritaires extrêmement poussés par Pékin sur son territoire et à l’accentuation d’une politique répressive à l’international (sans engagement militaire avéré en dehors des troupes engagées dans des opérations de l’ONU).
Dilnur Reyhan et Gulbahar Jalilova sont ouïghoures. Elles se battent pour que le monde ouvre les yeux sur le virage génocidaire pris depuis fin 2016 par le régime de Pékin dans le Xinjiang. https://t.co/veMGej8CJP pic.twitter.com/rFRQlzUyuu
— Mediapart (@Mediapart) November 22, 2020
Le travail d’influence de la Chine à l’ONU, le développement de ses partenariats et son activisme dans de nombreuses enceintes multilatérales (dont elle est parfois à l’initiative) comportent souvent une dimension de poursuite d’individus (ouïgours, mais aussi tibétains, pratiquants du Falungong ou activistes pro-démocratie de Hongkong ou taiwanais) à l’étranger. D’ailleurs, plusieurs États ont remis à la Chine, après des demandes d’extradition, des ressortissants ouïgours, supposés être liés à des filières terroristes (Égypte, Thaïlande, etc.).
La question des droits humains, objet majeur des relations internationales (essentiellement pour l’Occident, particulièrement pour l’UE) ne semble pas être décisive pour la majeure partie des États de la planète, dont la Chine constitue souvent le premier partenaire commercial. La relation avec Pékin est plus importante que les questions politiques et humaines. En cela, la Chine populaire a réussi à vaincre sans combattre.
Emmanuel Véron, Enseignant-chercheur – Ecole navale, Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) et Emmanuel Lincot, Spécialiste de l’histoire politique et culturelle de la Chine contemporaine, Institut Catholique de Paris
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
Image : champ de céréales dans la vallée de Wakhan, dans la région de Gorno-badakhshan, à la frontière entre le Tadjikistan et l’Afghanistan. Le couloir de Wakhan. Ce domaine est du côté afghan.